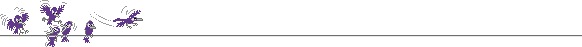
Texte extrait du Dictionnaire historique et archéologique des paroisses du diocèse de Tulle, par l'Abbé J-B POULBRIERE (1894)
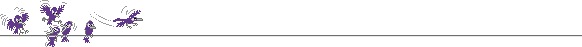
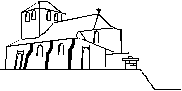 Le PUY d'ARNAC
Le PUY d'ARNAC
Canton de Beaulieu, arrondissement de Brive, ancien archiprétré de Brivezac. Superficie : 1227 hectares ; population 948 habitants ; distance du chef-lieu cantonal : 9 kilomètres.
Le Puy d'Arnac (Podium Asnaci) est une colline calcaire, abrupte par endroits, inculte presque partout, qui termine au nord-ouest la ligne des coteaux de Beaulieu. Ceux qui s'y rattachent dans la paroisse même dont il porte le clocher, eurent des vignobles autrefois les plus réputés du canton, aujourd'hui primés justement par ceux de Queyssac et ceux de Beaulieu même. Mention en est faite avec honneur dans les vieux dictionnaires géographiques et l'on a tout lieu de croire qu'Ussel les mettait au premier rang. Quand dom Boyer soupa dans cette ville, chez Moncorier, le 11 octobre 1711, le curé, M. Ternat, lui "envoya du vin de Puy d'Arnac", évidemment comme l'un des meilleurs, sinon du meilleur de sa cave. L'histoire facétieuse du Prince Grec parle aussi, à l'article du dîner, "des fumées du vin de la côte d'Arnat". En 1698, de Bernage, intendant du Limousin, constatait que les habitants de Tulle s'approvisionnaient de même au Puy d'Arnac. Il n'en estimaient pas moins le vin que ceux d'Ussel, car par ordonnance de messieurs les maire et consuls de leur ville, en date du 14 novembre 1675, "la pinte de vin nouveau de Puydarnac était réglée à trois solz quatre deniers, celuy de Grandroche et St-Bauzire à même prix, celuy de Varez à 3 sols et celui de Tulle à 2 sols" seulement. Malheureusement le phylloxéra dévaste aujourd'hui ce vignoble et de tout temps la grêle lui a fait une guerre acharnée : on a dit plus d'une fois que, sur trois années une, la malheureuse colline en subissait le fléau.
Le Puy d'Arnac domine sur son flanc d'est la belle "plaine" de Nonars et sur son flanc d'ouest le vallon plus distant de la Sourdoire, qui baigne, par delà les villages, le coteau bien en vue de Curemonte. Coup d'oeil très étendu de ce côté, plus restreint mais très gracieux de l'autre ; site également très favorable à l'établissement d'un château-fort.
De fait, un castrum existait au Puy d'Arnac dans des temps fort anciens et fut, à ce qu'on croit, démoli sans pitié par Pépin le Bref lorsque ce fondateur de la dynastie carlovingienne vint en 765 dévaster le pays de Turenne et celui d'Yssandon. Il n'en fut pas moins au IXe et Xe siècles le chef-lieu d'une vicairie passablement étendue, voire même d'un pagus ou petit pays qui se perdit plus tard dans celui de Turenne, tout en laissant subsister la vicairie. J'essaierai de dire un peu plus loin ce qui sortit des ruines de ce castrum dans les temps féodaux.
L'église d'Asnac -car tel était le nom primitif, Asnacum, et l'on ne parle que depuis quelques siècles du Puy d'Arnac- l'église d'Asnac, dis-je, aurait été la propriété de Solignac, qui, de Brivezac à Chauffour, occupa pendant un temps toute une bande du Pagus. Plus tard, l'abbaye de Beaulieu l'aurait revendiquée, mais sans justifier par son cartulaire de la réalité ou tout au moins de l'ancienneté de sa possession. En somme, ce sont les évêques de Limoges qui ont nommé le plus souvent à la cure : aussi ne veux-je insérer que pour l'acquit l'alinéa suivant du prieur de Beaulieu, Armand Vaslet.
"Saint-Etienne du Puy d'Arnac. L'évêque y a nommé en 1724 et l'a eue, à cause qu'on n'a pas trouvé la nomination et prise de possession du nommé par l'abbé : elle a été enlevée." (Abrégé de l'histoire de l'abbaye de Beaulieu, écrit en 1727).
Ce n'était pas une cure de médiocre importance que cette cure du Puy d'Arnac. Outre qu'elle était en pays plein de foi, on l'estimait temporellement d'assez bon revenu pour la taxer aux décimes 560 livres. On la faisait ainsi la première du bas-Limousin après celle de Chamboulive (769) et celle de Nonars, sa voisine, avec ses 474 livres, ne venait qu'après elle, à certaine distance.
Armand Vaslet vient de nous dire quel en était le patron : saint Etienne, premier martyr, honoré autrefois le jour de l'Invention de ses reliques, 3 août, comme dans les églises assez rapprochées d'Altillac et d'Astaillac ; ce qui aurait pu faire transférer la fête votive à un autre jour du mois, le 16, consacré à saint Roch. Jouissant dans l'église d'un autel et d'une confrérie, ce dernier bienheureux, dont les pestes ont vraisemblablement introduit et popularisé le culte, se trouve ainsi en possession de la solennité depuis l'année 1625 tout au moins. Il s'est ajouté à sa fête une autre fête plus tard, de par un voeu que les paroissiens firent devant notaire, le 27 avril 1727, à saint Pierre de Vérone, comme au gardien de leur vignes : ils prenaient l'engagement de solenniser perpétuellement le jour de ce saint, 29, sur le pied même des solennités les plus grandes, en y célébrant tous les offices de l'Eglise et en s'y refusant d'entrer jamais dans un débit de vin : promesse qu'ils ont parfaitement tenue jusqu'à ce jour et qu'il se font honneur de bien tenir encore.
Voici la liste des titulaires connus : 1449, Etienne Solabel, fondateur en 1461 d'une vicairie dont il sera parlé bientôt ; 1480, Jean Solabel, dit en 1496 recteur d'Arnac, ce qui indique que le nom alors usité de Puy d'Arnac ne s'était substitué que depuis peu à l'ancien ; 1540, Jean Escarravage ; 1551, Antoine Faure (Fabri) ; 1586, Pierre Segnabaud (provisions) ; 1599, Pierre Bétourny (prise de possession) ; 1640, Guillaume de Geneste, prévôt des Plas, dans la paroisse actuelle de Saint-Clément ; 1648, Antoine Texier, dit ancien curé en 1670 ; 1671, Jean Texier, sous qui furent bénites, le 20 septembre, deux cloches, l'une en l'honneur de saint Etienne, la plus grande, et l'autre en l'honneur de saint Ferréol, qui était aussi l'un des saints particulièrement honorés au Puy d'Arnac ; Jean Texier paraît avoir eu pour successeur après 1680 Jean-Baptiste Texier, de la même famille, qui en 1712 donnait à réparer son église : il fit la même année son testament, par lequel il laissait à cette même église calice, custodes, ostensoir et boites des saintes huiles, le tout en argent, acheté à ses frais ; 1713, Joseph-Mathieu Force (résignataire du précédent), qui donnait à réparer la chapelle de saint Roch en juin 1724 et mourrait le 14 novembre suivant ; même mois, Pierre Davril, qui en 1730 faisait réparer le clocher et en 1731 affermait, sans autre réserve que la moitié du chanvre, tout les fruits décimaux de sa cure à trois bourgeois de la paroisse, pour 2.000 livres chaque année ; plus 120 fagots de paille, plus 50 livres d'épingles pour sa soeur, sans faire figurer dans cette afferme ni les dîmes que lui donnait le comte de Sauveboeuf, de Nonars (principal seigneur de la paroisse), ni celle du Marquis de Ligneyrac pour le domaine de Beyssen, ni deux autres encore du même genre ; 1740, François de Lavergne de Farge, mort d'après Nadaud en 1768 ; il aurait, cinq ans auparavent, résigné à François Chaverebière, qui en 1783 aurait laissé le poste à son vicaire et neveu, Jean-Baptiste-Joseph Chaverebière : l'un et l'autre traversèrent la Révolution ; 1803, N. Perrinet ; 1804, Jean-Joseph Brel, ancien bénédictin qui continua de porter son habit ; 1821, N. Chastang ; 1823, Jean-Joseph Broue, qui n'accepta trois ans après la direction du grand séminaire de Tulle qu'à la condition de retenir son titre curial, ce qui ne laissait par conséquent que celui de vicaire-régent à françois-Cyprien Valade, chargé de la paroisse jusqu'en 1832 ; alors M. Broue y rentra, pour l'échanger dix ans après contre un canonicat de Tulle ; 1842, Germain Brandely ; 1846, Etienne Bazetou, dont M. Bourneix, curé de Nonars et son élève, nous a raconté les oeuvres et la vie dans une brochure signalée à l'article Maussac ; 1862, Jean-Baptiste Chapel ; 1876, Pierre Palide, et 1870 Julien Garenne, sous qui l'église, volée de ses vases sacrés le 8 octobre 1883, a regarni sa sacristie et refondu l'une des cloches, devenue présentement la plus forte du canton.
On a dit du premier des curés de cette liste qu'il avait fondé en 1460 (14 mars, v.s.) une chapellenie : cette chapellenie, dite de sainte Catherine et à l'autel de la sainte martyre, avaint pour collateur le prévôt de Brivezac et pour patronne la famille du fondateur, c'est à dire les Solabel, bourgeois de Saint-Sylvain. Elle devait être assez bonne, car en 1692 deux de Jaucen, seigneurs de Poissac, promirent à son titulaire Julien-Xavier de Fénis, curé de Sainte-Fortunade, s'il voulait la résigner à l'un d'eux, 200 livres tournois, plus deux muids de vin de pension. Fénis la céda en effet, et sept ans après, Gabriel de Jaucen, chanoine de Saint-Martin de Tulle, la résignait de même avec ses autres bénéfices en faveur d'Antoine Darche du Pouget. Mais par arrêt du parlement de Bordeaux et décision de l'évêque de Limoges l'année 1701, il fut réglé que cette vicairie serait à l'avenir annexée à la cure.
Il y en avait deux autres, l'une dite de l'Escurotte, connue en 1650, et l'autre del Perrier, en 1657. M. Bazetou, auteur d'un aperçu sur sa paroisse publié en 1883, croit qu'elles avaient pour sièges deux chapelles distinctes de l'église, celle de l'Escurotte "bâtie au Puy d'Arnac, en 1620, probablement au lieu qu'on nomme encore Lachapelle" et une seconde "fondée en 1653 dans les environs de Belpeuch (village de la paroisse), du côté de Lestrade (village de Nonars) ;" mais il est à noter que chapelle et chapellenie ont le même sens pour M Bazetou.
Solitaire sur sa crête mais disposant pour ses processions de l'aride plateforme de la Cafouillère, toute jalonnée de croix et jadis cimetière d'où la pioche tire encore des sarcophages très anciens, l'église du Puy d'Arnac est une vieille église romane, bien des fois remaniée depuis sa construction. Le mur d'ouest qui en date, sauf son portail, d'ouverture récente, devait être autrefois sans entrée. J'en juge par une belle porte à voussures, du XIIIe au XIV siècle, percée alors dans le mur du midi et maintenant faisant arceau dans le bas-côté qu'on a fait en 1854 sur ce flanc de l'église. Les bas-côtés, au Puy d'Arnac comme ailleurs, - du moins en beaucoup d'autres lieux - ont eu pour point de départ des chapelle latérales de la période flamboyante : en renversant les murs de séparation de ces chapelles, on ménage assez facilement au grand vaisseau les ailes dont aujourd'hui il peut avoir besoin. La première chapelle au nord n'était pas aussi ancienne que les autres ; à la clef d'une de celles du midi se distingue un lion, peut-être des Lostanges. Le grand tableau du maître-autel porte pour signature : F. BROSSARD... Tvtelloe, 1642 ou 4. François Brossard était effectivement maître-peintre de Tulle au milieu du XVIIe siècle. Son tableau du Puy d'Arnac représente le martyre de saint Etienne, premier patron de la paroisse et titulaire de l'église.
Le presbytère, situé à l'est de cette église, en est, à deux maisons près, l'unique compagnon. C'était autrefois un manoir, détaché de l'ancien château du lieu et appartenant en 1720 aux Veyrac de Sailhac. Le 6 mai de cette année, moyennant procuration pour cause d'hypothèques de Jean de Veyrac, docteur de Sorbonne, prieur de Beauregard et aumônier du roi d'Espagne, noble Jacques de Veyrac, écuyer de Sailhac qui l'avait en propriété, le vendit aux prêtres de l'endroit pour y servir de presbytère. Des tours disséminées entre ce bâtiment et l'église, puis au sud vers divers angles d'un champ dont la haie de ce côté recouvre un mur d'enceinte, indiquaient autrefois le périmètre du château du Puy d'Arnac : château qui, tout en n'étant peut-être qu'une ombre du vieux castrum renversé par Pépin, se trouvait encore le siège d'une seigneurie vendue partiellement, depuis longues années, et passée par ses principaux maîtres au repaire del Moly (1330) ou château du Moulin-d'Arnac, dans la paroisse de Nonars.
Voici courte mention de cette seigneurie dans un Etat des terres et fiefs les plus distingués relevant au dernier siècle de la vicomté de Turenne : "Asnac, ancien fief avec paroisse en justice, divisée entre plusieurs seigneurs. - Hommagée en 1334, 1350, etc. - A MM. Les comtes de Plas, de Sauveboeuf et autres." D'après un autre Etat des châtellenies composant la même vicomté, Puy d'Arnac, à M. Le marquis de Sauveboeuf, dépendait, mais non comme membre, de la châtellenie de Turenne pour 26 villages et 271 feux. En 1760, la juridiction, ainsi que celle de Nonars, en appartenait au Moulin-d'Arnac, la résidence précitée du marquis de Sauveboeuf. Là cet important personnage se trouvait succéder à plusieurs familles notables, énumérées dans l'article Nonars et parmi lesquelles ou plutôt en tête desquelles il faut mentionner la famille du nom, celle d'Asnac ou d'Arnac, connue du Xie au Xve siècle. C'est un Bernard d'Asnac qui aurait démembré sa seigneurie en transportant peut-être sa résidence. On en trouve titrés seigneurs en dehors de ses héritiers, un Sahuguet au XVIIe siècle, des Aymar de Curemonte ou de Lostanges aux XVe et XVIe, puis, à la suite, des de Plas qui succédaient peut-être aux Aymar, sauf que les successeurs des ces derniers aient été les Veyrac (1)
Beyssen, village de la paroisse, fut aussi un fief dépendant de Turenne et à lui hommagé en 1519, 1601, etc. Sa chapelle en l'église du Puy d'Arnac était celle de la Vierge actuellement, de saint Guy dans le passé. Il est à remarquer qu'un Guy de Beyssen figure comme témoin au cartualire de Beaulieu sur la fin du XIIe siècle. Un autre de Beissienc, initiale A, remplit le même rôle en 1203.
C'est un Lostanges (Antoine) qui en était le seigneur en 1560 et de là l'écu du XVIe siècle recueilli sur un linteau de porte par M. Bournex, curé de Nonars : d'argent au lion de gueules armé et lampassé d'or, couronné d'azur : accompagné de cinq étoiles de même, 2, 2 et 1. Le château - car château il y avait - appartint ensuite aux Robert de Ligneyrac, qui l'avaient encore dans le premier tiers du dernier siècle, puis il fut en 1744 à noble Jean de Gimel, seigneur de la Feuillade. L'écu des Ligneyrac s'y trouve dans un mur : d'argent à trois pals de gueules ; il y est uni aux armes des Tubières-Caylus, léguées à la famille des Robert peu après 1700 : d'azur à trois molettes d'or avec un chef de même.
Bonneval, connu dès 927 par des dons de mas au monastère de Beaulieu, appartint aux Cosnac de Saint-Michel (Lot) qui, de ce village, poussèrent sur Ussel leur petite ramification.
Les Cosnac, on le sait, par deux de leurs membres fondèrent le petit séminaire de Brive dit de la Marque. Il paraissent l'avoir doté du bien de Savinou, autre village de la paroisse ayant pu leur venir par alliance des de Plas, qui s'en disaient seigneurs au XVIe siècle. Quoi qu'il en soit, les archiprêtres de Brive, après Clément de Cosnac, l'un d'eux, régirent ce bien comme directeurs du petit-séminaire et en union avec la famille. Possible est aussi que les Plas eussent fait là quelque don aux Jésuites de Beaulieu, car on y trouve en 1639 exerçant certains droits le R.P. Salamon, de la Mission de cette ville, commis à cet effet par le R.P. Mazor, syndic de la même Mission. Il ne reste aujourd'hui de Savinou qu'un pan de mur sans caractère. Si on l'a dit le plus souvent domaine noble, on l'a quelquefois appelé prieuré. Sa cave, aux abord de laquelle armes des de Plas, prote même le nom de cave des Templiers.
L'Audubertie, village considérable et traversé par une route, avait une famille Audubert, dont il garde le nom. Cette famille venait de monter à la noblesse sur la fin du XVIIe siècle et l'on peut voir ses armes dans la maison qu'elle habita : un cygne sous un chevron avec trois étoiles en chef. En 1711, le 20 mai, Catherine d'Audubert, fille ainée et plus tard héritière de jean-Pierre d'Audubert, écuyer, sieur de la Martinie, contacta mariage avec Alexandre d'Anterroches, chevalier, seigneur de Combrelle en Haute-Auvergne et capitaine de dragons. Ce représentant d'une famille bien connue par la chevaleresque et célèbre parole à Fontenoy du Lieutenant-général dont elle s'honore : "Messieurs les Anglais, tirez les premiers", vint faire alors au Puy d'Arnac une branche encore existante dont les représentant mâles sont aussi des officiers : l'un d'eux, malade, habite Beaulieu (1897).
Dans cette ville comme au Puy d'Arnac, on garde avec bonheur le portrait d'un jeune religieux qui fut au XVIIe siècle la gloire des Audubert et l'honneur trop peu connu de notre province.
Guy Audubert, agé seulement de vingt ans, avait entendu l'appel de Dieu et quitté le monde pour prendre à Chancelade, en Périgord, l'habit blanc des chanoines réguliers. C'était au moment où le bienheureux Alain de Solminhac, abbé de cette abbaye, plus tard évêque de Cahors, travaillait à la régénération de son cloître, comme il devait travailler ensuite à celle de son diocèse. Il eut dans son jeune novice un auxiliaire très précieux. L'auteur de la vie du saint réformateur, Léonard Chastenet, prieur de Chancelade, consacre tout un chapitre, le Xve, à nous parler de Guy Audubert ; il annonce même une biographie particulière qui malheureusement n'a jamais vu le jour. De son exposé cependant, quelque bref qu'il soit, résulte l'impression d'une sainteté des plus surprenantes, - d'autant plus surprenante que quelques mois à peine avaient dû suffire à le faire mûrir. Jamais, paraît-il, on n'avait vu dans le cloître un religieux plus assidu à tous ses exercices ni plus épris des vertus que le cloître aime à faire fleurir : l'humilité surtout, la mortification, l'obéissance, l'entier dépouillement de soi. Alain de Solminhac en était dans la stupéfaction. Il eût ardemment souhaité conserver ce modèle, mais le ciel s'empressa de le ravir. Guy Audubert ne demandait à Dieu que de souffrir et de mourir comme l'avait fait son Rédempteur : il fut exaucé. Une fièvre intense s'empara de lui ; sa langue noircit, tous ses membres brûlèrent pour ainsi dire, les uns après les autres, il tomba en agonie. "Prions pour son âme", dit un moment le Père abbé, le croyant mort ; mais l'affaissement qui venait de se produire n'était que de la préparation d'un triomphe sur terre, prélude éclatant de la gloire qui attendait au ciel l'humble novice. Etendu sur son lit comme sur la croix, il parut tout à coup transfiguré ; sa face s'illumina, il fit des prédictions, reçut la visite de la Sainte Vierge et de saint Augustin, puis s'envola sur la permission de son supérieur, en véritable enfant d'obéissance qu'il était et qu'il fur jusqu'au dernier soupir ; deo jubentes et te permittente, ego morior... On écrivit sur la toile qui conserva ses traits : Le bienheureux frère Guy Audubert, chanoine régulier de l'ordre de saint Augustin, mort en 1635 à l'age de 21 ans.
Sont villages du Puy d'Arnac : l'Audubertie, Beauregard, Belpeuch, le Bessou, Beyssen, Bonneval, la Borderie, le Breuil, la Brousse, la Cafouillère, le Carou, le Cellier, Champestran, Champlong, la Chapelle, sur l'emplacement d'une église appelée du Pantée ou de Laval (nom d'un village de Nonars, assez voisin), qui fut donnée en 861 à l'abbaye de Beaulieu par un nommé Dacon et par sa femme Adalsinde; la Chastroule, la Chèze, la Combarelle, la Coste, la Coustoune, la Croix, le Crouzat, Escaravage, dont se nommait en 1453 Pierre de Cardaillac, de la maison de ce nom à Curemonte et à Végennes ; la Fardine, Farges, Faure bas, les Fourches, la Garenne haute et basse, l'Habitarelle, la Jarrige, la Jugie, Malcourse, qui fut aux Ligneyrac ; la Marbotie, la Martinie, la Mauginie, Mazinte, Montmézo, le Moulin de Fougères, le Peyratel, Peyroux, Pierre-sèche, le Pont de Marcillac, le Peuch, la Pougeade, Prat, Prillac, le Puy del Trel, la Range, plus connue sous le nom de Chez-la-Jeanne, le Roussel, Sarpiat, Sapiente, Savinou, la Saviotte, Soleilhet, le Suquet, le Teilhet, Trémoulière, Venéjoux, Viallon, et Vignegrande.
-----
(1) Le prêtre distingué cité plus haut n'aurait-il pas été lui-même Jean de Veyrac, passé de son pays en Espagne où il resta vingt ans, revenu à Paris en 1710 et auteur d'une bonne traduction des mémoires du cardinal Bentivoglio, d'une description de l'Etat présent de l'Espagne, 1719, et d'une Histoire des Révolutions de ce pays, même année ? Feller en fait l'éloge au tome XII, p. 304, de l'édition Pérennès.
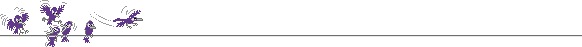
[Puy d'Arnac] © 29/4/1996, JF
Perrier